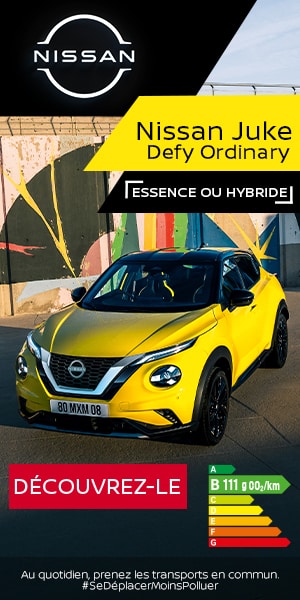Un an après sa médaille d’argent à Tokyo, la championne d’aviron Laura Tarantola fait le bilan. Difficultés rencontrées dans le sport de haut niveau, démarches auprès des sponsors, engouement olympique : elle brosse le portrait d’un sport français qui a encore du chemin à faire, à deux ans des Jeux olympiques de Paris en 2024.
Vous faites partie du dispositif SNCF depuis 2019. En quoi cela consiste-t-il pour vous ?
J’ai terminé mon cursus à l’école de commerce de Grenoble en 2019, et je voulais vraiment trouver du travail. Je ne me voyais pas faire seulement de l’aviron. Pour moi, c’est très important de continuer à apprendre de nouvelles choses. C’est une question d’équilibre, entre les vies sportive, professionnelle et personnelle. C’est aussi un moyen d’anticiper la fin de ma carrière sportive. L’aviron, on n’en vit pas en France, alors c’est primordial de faire des études et d’avoir un emploi à côté. J’ai eu l’opportunité d’arriver à la SNCF, en tant que chargée de projet de la qualité de vie au travail, un thème qui m’intéresse. Plus précisément, je suis embauchée en CIP, contrat d’insertion professionnelle, avec des horaires aménagés. Cela représente au total 50 jours par an de travail. Ça peut paraître peu, mais c’est déjà bien difficile à caler dans notre calendrier.
« Quand tout roule du côté des sponsors, on peut totalement se concentrer sur le sportif »
Cet aménagement est essentiel pour continuer à mener votre carrière à haut niveau ?
Totalement. Ce contrat me permet d’avoir du temps dégagé pour les entraînements, les compétitions, les stages. Dans l’aviron, nous sommes en stage avec l’équipe de France au moins 200 jours par an. Alors, c’est essentiel d’avoir cette souplesse. Cela reste des semaines très chargées, une vraie organisation, mais l’équilibre est possible et rendu plus aisé. En général, je suis sur un rythme d’un à deux jours par semaine. Cela donne des journées intenses : entraînement de 7 h à 9 h, au travail de 10 h à 17 h, et de nouveau entraînement le soir. Clairement, on ne peut pas faire ça tous les jours ! Mais moi, j’adore, j’aime beaucoup retrouver l’équipe de travail, être utile, voir autre chose et s’aérer l’esprit… Il faut toutefois admettre que parmi mes deux projets, c’est souvent le sportif qui prend le dessus. D’autant plus à l’approche des Jeux olympiques chez nous, à Paris, et ça, tout le monde l’a bien compris.
Avez-vous observé, à l’approche de ces Jeux olympiques, un intérêt grandissant des sponsors ? Quelle est votre situation vis-à-vis d’eux ?
Pour ma part, ça s’est fait plutôt sur le tard. J’avais été championne du monde en 2018, et les Jeux approchaient. C’est à ce moment-là que j’ai accéléré pour essayer de trouver des partenaires. C’est un travail qui demande énormément d’investissement et de temps, et ce n’est que depuis quelques années que j’en récolte les fruits. C’était un peu un défi, de réussir à ne pas galérer, même si c’était la généralité dans mon sport. J’ai eu la chance de trouver des partenaires qui me soutiennent, et qui désormais embrayent sur mon projet Paris 2024. Ça me permet d’avoir une vraie sérénité. Quand tout roule du côté des sponsors, on peut totalement se concentrer sur le sportif. Ce n’est pas facile pour tout le monde, et il n’y a pas vraiment d’accompagnement extérieur. Chacun essaye de se débrouiller avec ses moyens. Pour ma part, j’ai la chance de pouvoir compter sur un très bon noyau, qui me permet déjà de me sentir bien dans mes baskets.
« Après les Jeux de Tokyo, c’était un peu la désillusion »
Après votre médaille d’argent à Tokyo en 2021, était-ce plus facile de trouver des partenaires ?
C’est sûr qu’après les Jeux, il y avait beaucoup de sollicitations, d’un peu partout. Mais finalement, rien de concret. En fait, c’était une période très creuse, c’était un peu la désillusion. Je m’étais toujours dit : « un médaillé olympique, tout le monde l’appelle et le veut. » Mais en fait, non, pas tellement. Au bout de quelques mois, je me suis fait une raison. Je me suis dit que de toute façon, on ne faisait pas de l’aviron pour la gloire ou l’argent ! Pour moi, c’est un sport-passion, et je ne le vois pas autrement. Mais c’est sûr que pratiquer son sport à haut niveau et pouvoir gagner sa vie avec, c’est une vraie sérénité, qui permet d’éviter de se poser des questions et de donner le meilleur.
La dynamique de Paris 2024 a-t-elle fait changer les choses ?
En tant que sportifs français, on a une chance immense d’avoir les Jeux olympiques à Paris. Plus la date approche, plus on entend parler des bénéfices que les entreprises peuvent faire en sponsorisant des sportifs. A la fois en termes d’image, mais aussi en accueillant des champions à l’intérieur de l’entreprise. Entre le monde du sport et le monde professionnel, il y a des parallèles géniaux. Ça se réveille ces derniers mois, ces dernières semaines, mais « l’effet Jeux olympiques » s’est fait attendre. Dans les deux ans à venir, les choses vont encore s’accélérer, on sent une effervescence. Mais Paris 2024 ne se prépare pas un an avant l’échéance. C’est vraiment maintenant, et même depuis un moment, qu’on a besoin de soutien si on veut être prêt à briller chez nous.
« L’effet JO s’est fait attendre »
Est-ce que vous pensez que les sponsors se rendent vraiment compte de ce que c’est, d’être sportif de haut niveau ?
Je pense que, comme tout le reste de la société en général, ils sont conscients des besoins, oui, mais ils ne se rendent pas forcément compte que la grande majorité des sportifs galère. Si on n’est pas footballeur dans un grand club, ou tennisman dans le haut du classement mondial, on gagne difficilement sa vie. On a tellement ces images, avec des sommes indécentes pour certains, qu’on n’imagine pas que des champions olympiques puissent vivre sous le seuil de pauvreté. Je me rappelle d’une étude après les Jeux de Rio, où on avait appris que plus de la moitié des sportifs français aux JO vivaient avec moins de 500 euros par mois. Si on n’est pas du milieu, c’est normal de ne pas se rendre compte de la situation. Mais la réalité, c’est que tous les sportifs, en particulier dans des disciplines peu médiatisées et non salariées, ont vraiment besoin de soutien.
Quand vous vous êtes pleinement lancée dans l’aviron, est-ce un aspect du sport de haut niveau que vous aviez imaginé ? Les revenus, les sponsors…
Non pas du tout ! J’ai toujours entendu que dans l’aviron, tout le monde galérait. Alors je savais depuis le début que je ne faisais pas ça pour m’enrichir. Quand j’ai commencé, je n’imaginais même pas arriver en équipe de France. Petit à petit, on trouve des mains tendues, des gens intéressés par notre profil ou notre projet. C’est difficile de se vendre : moi mon job, c’est de performer, et démarcher. Chercher en permanence demande beaucoup d’énergie. A mon avis, il faudrait aussi plus d’accompagnement et de sensibilisation auprès d’entreprises qui aimeraient aider des sportifs, mais ne savent pas comment faire. Toutefois, il y a de plus en plus de sponsors qui proposent des contrats comme le mien à la SNCF, ou même des partenariats divers. J’ai quand même le sentiment que ça avance dans le bon sens.